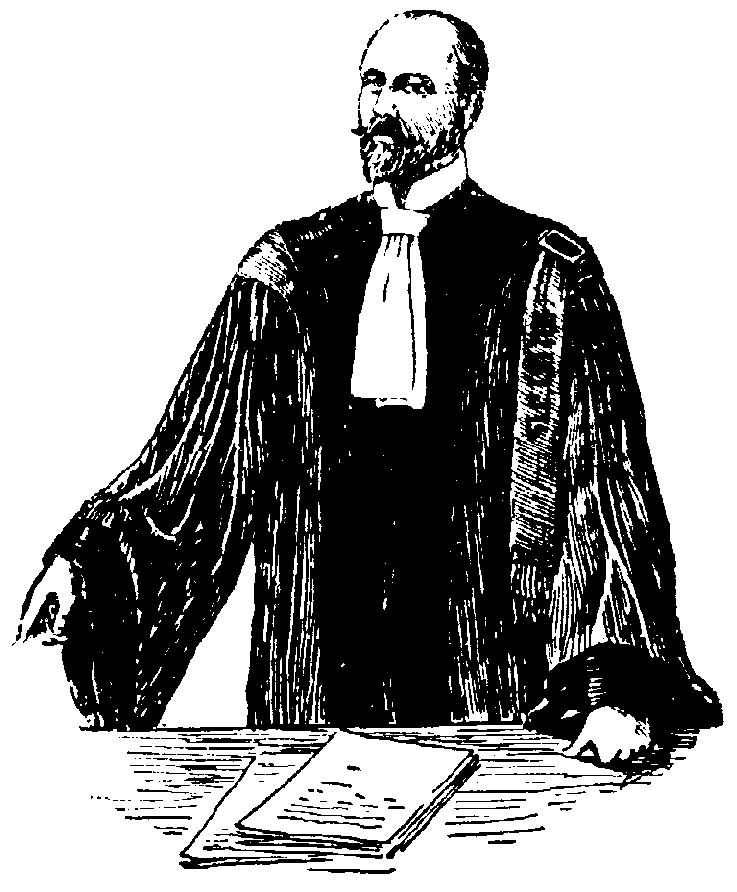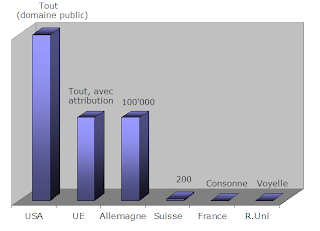Il y a quelques temps, Erdrokan
nous expliquait que ses collègues ne savaient pas qu'il contribuait à Wikipédia. C'est exactement l'inverse sur mon lieu de travail (pour situer, je travaille dans une institution privée, mais liée au milieu académique), où je n'ai pas mis longtemps à être connu comme "M. Wikipédia". C'est assez intéressant, et amusant: ça anime quelques fois la conversation au repas de midi; si je contribue rarement depuis le travail, mes collègues savent qu'à certains moments "chauds", tel que la
(non)réelection de Christoph Blocher, je peux passer un petit moment à jongler pour mettre à jour des articles ou annuler du vandalisme. Des fois, c'est le
natel téléphone portable qui sonne, et pendant que je quitte le bureau, mes collègues ont le temps d'entendre "
oui, c'est bien un numéro lié à Wikipédia, mais non, je n'ai aucune information sur la récolte des oranges ou si Warren Buffet accepterait de sponsoriser votre idée géniale" (exemples véridiques). Il y a un côté pratique aussi: certains de mes collègues font office de "rabateurs" en me signalant des articles de presse intéressants ou des articles Wikipédia à corriger. Malheureusement, je n'ai encore réussi à convaincre aucun d'entre eux de contribuer plus qu'une ou deux petites modifications, principalement par manque de temps, même si certains feraient d'excellents contributeurs.
Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Comme de coutume sur ce blog: j'essplique.
Avant-hier, je reçois de notre chargée de communication un email qui ressemble un peu à ça: "
il paraît que tu es éditeur sur Wikipédia; je cherche quelqu'un pour mettre à jour notre page (en version anglaise), je peux te fournir le texte prêt à insérer." Aïe, je ne l'avais pas du tout vu venir celui-là... la suite de la conversation est on ne peut plus classique et prévisible:
- (moi, très diplomatique) Tout le monde peut être "éditeur" de Wikipédia, et j'en profite pour donner quelques règles de base: éviter absolument le ton promotionnel, rester neutre, citer des sources indépendantes, etc
- (elle) Mais dans mon job précédent, une collègue qui n'était pas "officiellement" éditeur voyait toutes ses modifications annulées; et pourtant, elle les faisait de la part de l'organisation qui était sujet de l'article, elles étaient donc correctes.
- Oui, justement...
Je reçois aussi une copie des modifications proposées, pas de surprise: des phrases non-neutres typiques du genre "
sa mission est de fournir des prestations de première classe", "
des produits à la pointe", ou "
le système le plus utilisé au monde": il y a clairement du boulot d'explication à faire ! (même si au total il n'y aurait pas besoin de beaucoup de travail pour ne garder du texte que les informations entièrement factuelles, non controversées et sourcées correctement) Je commence par lui donner une copie du
livre de Florence Devouard et Guillaume Paumier, que j'avais justement sur une étagère, et on se lance dans une discussion plus détaillée...
Il n'y a probablement pas de solution idéale. Si la responsable de communication ou quelqu'un d'autre sans expérience sur Wikipédia fait des modifications, elle prend le risque d'ajouter un contenu semi-publicitaire, qui aurait l'effet inverse que celui attendu en termes d'image. D'un autre côté, il est hors de question que je fasse les corrections sous mon propre nom d'utilisateur
pour des raisons évidentes. Un compromis serait de créer un nouveau compte (un
faux-nez honorable) pour modifier l'article concerné, en étant transparent sur le fait que l'utilisateur travaille pour le compte du sujet de l'article, et en faisant attention de respecter les règles d'usage; en particulier, il ne voterait bien entendu nul part, et ce ne serait pas non plus un
compte collectif: une personne expérimentée s'occuperait de filtrer les demandes pour s'assurer que les modifications proposées respectent les règles de Wikipédia. C'est jouable, mais ça revient à marcher un peu sur la corde raide. D'autres solutions seraient envisageables mais aucune n'est parfaite.
Mais ce n'est pas la fin de l'histoire... il y a quelques temps, une plaquette présentant un projet avait été éditée en réutilisant
une image de Guillaume; après avoir félicité la chargée de communication pour avoir réutilisé une image libre en citant l'auteur et la licence, j'ai profité de placer dans la conversation la question logique: "
en plus de réutiliser du contenu libre, est-ce qu'il ne serait pas envisageable que nous prenions aussi la peine de contribuer en plaçant des images sous licence libre ?" Et la réponse a été enthousiaste: nous allons commencer à rechercher les images les plus intéressantes dont nous avons les droits et qui pourraient être ajoutées sur commons. Plus que pour une ou deux modifications de texte, c'est là que la création d'un compte dédié pourrait être particulièrement utile. A voir ce que ça donne, mais j'ai au moins trouvé une oreille attentive, qui, après quelques explications et une démonstration, a compris plusieurs choses sur le fonctionnement de Wikipédia, ce qui a permis d'éviter de remplir un article avec du contenu semi-publicitaire... comme quoi il est payant de passer un peu de temps à expliquer les choses en détails.
Edit: j'ai oublié d'indiquer que l'article en question existe déjà et est sans aucun doute admissible (avec des sources indépendantes disponibles), ce qui me rend la vie beaucoup plus facile que si mon employeur essayait à tout prix de se faire une place entre deux articles alors qu'il n'a rien à faire sur Wikipédia...