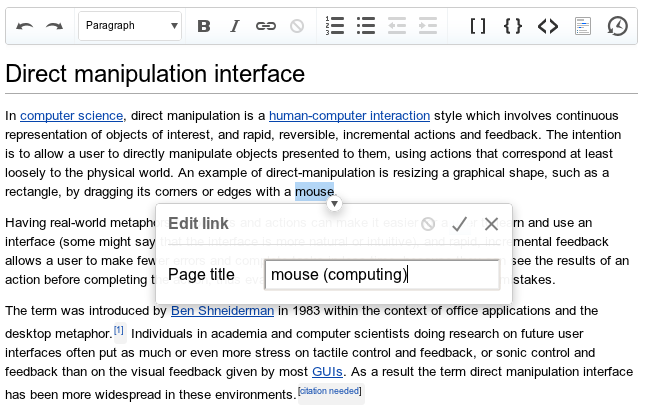Soit.
Il me semble ici que Wikipédia en italien serait la victime collatérale d'un projet de loi qui ne la vise pas. Notez que ce n'est pas vraiment nouveau: on a eu il y a quelques années la version anglophone qui était bloquée au Royaume-Uni pour la mise en ligne de la pédopornographique pochette de l'album
Virgin Killers du groupe de rock Scorpions, ou
ce projet de loi portugais à l'automne dernier, toujours dans les cartons, qui vise à rendre les droits d'auteur inaliénables mais, en passant, condamnerait tout schéma alternatif de type
Creative Commons - qui je vous le donne en mille sous-tend Wikipédia. Enfin, pour rappel, on a aussi vu le député allemand
Lutz Heilmann qui par décision de justice avait fait bloquer en référé l'accès à l'adresse www.wikimedia.de. Et je ne parle pas ici des propositions un peu plus fantasques qu'on voit passer à l'occasion, comme ce tout récent
rapport de sénateurs new-yorkais visant à interdire le troll et le bannissement sur les canaux informatiques... Le bouton de blocage des admins est menacé!
Luttes d'influence
Du coup, il est aussi normal pour Wikipédia - sa Fondation, ses chapitres locaux, ses utilisateurs- d'essayer de corriger le tir quand un sujet que ses contributeurs connaissent assez bien peut être indirectement affecté par des décisions ou projets de loi qui, à tout le moins, manquent d'inspiration. C'est tout le principe du lobbying, qui en France en particulier a bien mauvaise presse: au final, celui-ci ne fait pourtant que refléter la prise en compte d'intérêts particuliers ayant une connaissance pointue d'un sujet. Ceux-ci essaient d'influer dans un sens ou l'autre ceux qui décident de la politique générale
1. Les premiers lobbyistes, m'est avis, sont ainsi les élus par circonscription, censés défendre le bien commun mais aussi au passage les intérêts des gens de leur coin (ou en tout cas ceux de la grosse moitié qui les a mis en place). Autre exemple: parmi les lobbyistes
enregistrés auprès des institutions européennes on trouve une bonne moitié d'industriels (les premiers impactés par la politique de ce qui reste essentiellement le plus gros bloc commercial au monde), mais aussi 40% d'ONG, think-tanks, groupes académiques ou régionaux. L'important,
in fine, est de maintenir un haut niveau de concurrence entre différents groupes d'intérêts, de manière à ce que leurs influences se contrebalancent.
En revenant au contexte italien, on a donc un projet de loi qui
a priori vise à répondre à un problème particulier et qui, par inadvertance et/ou une formulation un peu hasardeuse, vise plus loin que ce que ses créateurs auraient pu penser. La communauté wikipédienne concernée
2 décide donc de réagir et d'essayer d'influer sur ce texte. La communauté wikipédienne italophone, consciemment ou pas, décide donc de faire du
lobbying. Bouh.
Que faire?
Tout choix politique, au final, se résume à un arbitrage entre gains et pertes potentiels. Toute décision a des effets négatifs, et tout le jeu pour un décideur consiste à savoir minimiser ces derniers. Suivant les caractères les priorités changent, mais en démocratie -en tout cas dans une démocratie occidentale moderne- un bon indicateur du sens du vent vient du retour médiatique que donnera telle ou telle décision: gouverner n'est pas seulement chercher la meilleure décision, mais surtout celle qui plaira au maximum de gens - ou déplaira au minimum. L'élu lambda, donc, écoute le bruit qui l'entoure.
Les italophones avaient au départ plusieurs options pour se faire entendre:
- Mener une politique d'engagement avec la presse, les parlementaires. Des rencontres, des meetings, des explications. Ca a en partie été fait, mais c'est quelque chose qui demande du temps et des moyens. Or au dernières nouvelles Wikimedia Italia est une association de volontaires, ne roule pas forcément sur l'or, n'a pas à ma connaissance d'employé dédié au relationnel;
- Mener une politique d'engagement plus générique, moins précise: c'est ce qu'on a apparemment tenté avec un sitenotice mis sur le site il y a quelques temps. Pour que ce sitenotice atteigne ses objectifs, il aurait essentiellement fallu qu'un (voire des) journaliste(s) ou parlementaire(s) tombe(nt) dessus, prenne(nt) le temps de le lire, et soi(en)t convaincu(s). L'efficacité potentielle me semble marginale -surtout avec des Parlementaires en majorité d'un age avancé. De fait, le projet de loi est resté à l'ordre du jour, inchangé;
- Faire du bruit. Beaucoup de bruit.
On voit qu'à ce stade les options sont en fait assez limitées. Vous noterez que je ne cherche pas à discuter la pertinence de l'analyse italienne quant aux retombées possibles de cette loi ou le fait d'utiliser le matériel encyclopédique pour arriver à leurs fins: l'important ici est qu'
eux, en temps que communauté, aient décidé que cela méritait action.
C'est ainsi qu'on est arrivés il me semble à cette décision de fermeture temporaire de la version italienne: l'attentat-suicide, au final, est l'arme du pauvre.
Boum
Quand j'ai appris la nouvelle de la fermeture du site, j'ai fait la chose la plus logique qui soit pour en mesurer l'efficacité: j'ai acheté le journal.
La Repubblica, pour être exact. Et j'ai effectivement trouvé un article sur cette fermeture:
Un quart de page dans la section "Politique"
3 plutôt que "Technologies", ça ne me semble pas si mal. Il y avait également des liens en première page des sites webs de
la Repubblica et du
Corriere della Serra: c'est bien aussi. Un rapide tour sur google news me montre qu'on a plusieurs milliers de citations à travers la presse nationale: c'est carrément bon - je connais peu de campagnes de presse qui peuvent se vanter d'une telle couverture, y compris
à l'international. On en parle encore aujourd'hui dans
la Repubblica, avec Jimmy Wales qui se fend d'une déclaration: un évènement couvert sur plusieurs jours, c'est vraiment, vraiment bon. Et
270'000 soutiens en 24h au groupe Facebook (et 430'000 liens vers le communiqué partagés sur des pages utilisateurs) c'est aussi toujours ça, pour ce que ça vaut.
La machine est donc lancée et, apprends-je toujours
via l'excellent blog d'Alexander Doria, il semblerait que le projet soit déjà en cours de modification. Pas encore là où on le voudrait, mais les lignes de front ont commencé à bouger.
Victoire, ou bien?
Bon, au final il ne faut pas faire la fine bouche: sans vouloir vendre la peau de l'ours, il apparaît que les italophones soient plus près d'obtenir la modification du texte qui les intéresse qu'il ne l'étaient il y a trois jours. Sans non plus leur donner tout le crédit -il y avait un contexte de protestations non négligeable-, ils auront probablement concouru à ce changement. La nouvelle du black-out a par ailleurs réussi à faire surface en dépit d'une actualité chargée: entre la dégradation de la note de la dette italienne et la mort de Steve Jobs, cela montre l'importance de Wikipédia au sein du paysage médiatique italien et, par extension, le crédit dont celle-ci jouit. Elle a contribué à faire évoluer le débat sur un point particulier qui la concerne, ce qui est une démonstration de force.
Victoire tactique, donc, comme on dit dans les infoboxes d'articles sur les batailles.
Au niveau stratégique, par contre, il faudra attendre de voir le texte final pour décider. Mais on a déjà plusieurs questions qui se posent:
- ce qu'on a fait une fois, qui prend tout le monde par surprise et les fait réagir, est toujours moins efficace quand on le ressort une deuxième fois. Quid de la prochaine proposition législative de la même eau, dans un, deux ou cinq ans?
- Est-ce que cela donnera aussi l'idée de faire pareil à d'autres versions linguistiques, avec le risque de dilution du crédit dont bénéficie Wikipédia si de telles décisions sont moins bien inspirées ou plus partisanes? Il est relativement inquiétant de penser que quelques dizaines de personnes puisse aussi rapidement prendre une telle décision - et WP.it est un gros projet: combien pourraient décider sur WP en danois?
- Cela aura-t-il un impact sur la toute prochaine campagne de dons?
On risque aussi d'avoir de sérieuses critiques: que ce soit à l'interne pour avoir abandonné une neutralité stricte, sorti la grosse artillerie et mis la Fondation devant le fait accompli; ou à l'externe pour avoir indirectement pris position contre le Parti des Libertés, qui n'est pas encore voué à disparaître
4.
Bref, tout ça pour dire que c'était un développement intéressant. Et à suivre.
1. Il faudra sinon m'expliquer comment on peut attendre que des élus du peuple soient tout d'un coup experts en éducation, droit matrimonial, droit pénal, assurance maladie, recherche fondamentale, droit bancaire et promotion de l'activité économique. Et ça, c'était uniquement pour les membres du Conseil national suisse, et uniquement pour le 30 septembre dernier.
2. A leur décharge, il faut souligner que dans de récents conflits la loi a permis l'assignation individuelle de membres de Wikimédia Italia pour des problèmes de contenu avec lesquels ils n'avaient rien à voir.
3. En fait c'est même "politique et justice", ce que je trouve très italien, comme association.
4. Et est même encore au pouvoir. Quoi que sur ce point c'était assez finement joué pour ne pas s'opposer à la loi dans son entier, qui dépasse le cadre wikipédien: WP.it a donc bien fait du lobbying et pas de la politique. Un des premiers amendements déposés l'a d'ailleurs été par un député PdL.